3) La société génère et subit ses propres stéréotypes
A) Une société dominée par ses stéréotypes
Il s’avère que les images des femmes
dérangeantes voire choquantes en matière de publicité sont les plus
nombreuses, et seraient donc plus porteuses, plus attrayantes pour les
consommateurs.
Le corps idéal est une instance symbolique édictée par la
société depuis toujours. Ainsi, à toutes les époques qui ont jalonné
notre existence humaine, des images d'un corps idéal sont créées, et la
société en place veut les ériger en norme et les imposer aux individus.
Mais l'ampleur du phénomène est récente. En effet, si chaque société
avance son idéal de corps, idéal auquel chacun tente de se conformer et
que tous déplorent de ne pas égaler, c'est dans nos sociétés
occidentales que l'idéal est le plus exigeant et donc le plus
inaccessible.
Cet idéal semble se balancer entre l'allure minimaliste des
mannequins et celle, athlétique, des bodybuilders. Celle qui va nous
intéresser est celle des mannequins, mais ces deux idéaux, pourtant
apparemment différents, ont en fait le même but, à savoir éliminer la
chair en excès, la mollesse, le relâchement. Ces ennemis sont synonymes
de laisser-aller, intolérable aujourd'hui, et de manque de caractère,
de faiblesse, de lâcheté, de non contrôle sur son corps, et donc sur sa
personne et sur sa vie.
Les femmes grosses, obèses ou avec un visage peu avantageux
suscitent, inconsciemment, de l'indignation et de l'hostilité. Une
personne "qui le vaut bien" se doit de prendre un "soin intense" de
son corps en le délivrant de la vieillesse, des imperfections, de la
lourdeur, des dissymétries... des aléas de la vie. Une femme "mince"
est une femme "belle".
Une silhouette longiligne est non seulement le symbole de la
beauté corporelle féminine, mais aussi la quintessence de la réussite
sociale, du bonheur et de la perfection. La minceur est devenue une
valeur qui confère des qualités telles que le charme, la compétence,
l'énergie et le contrôle de soi.
Le jugement moral sur les personnes passe d'abord par le
physique, par une évaluation du "paraître". Ainsi, un corps mince ou
musclé est non seulement la clef du succès, mais aussi le moyen
d'obtenir la reconnaissance sociale et l'acceptation morale. La
sanction liée à la non-conformisation au stéréotype de beauté dominant
est une sanction informelle et négative, qui est subliminale, diffuse
dans l’ensemble de la société et permanente.
D'après le psychologue clinicien Michaël Stora, « la société
ne propose pas suffisamment de lieux de valorisation » à ses individus.
Dès la maternelle, les enfants beaux sont
privilégiés : les
enseignants ont une meilleure opinion d’eux et leurs camarades les
préfèrent. Ceci génère une attitude positive et l’enfant a plus
confiance en lui, ce qui favorise sa réussite scolaire et entraine sa
réussite professionnelle. En effet, la différence de salaire entre les
"beaux" et les "laids" est d’une ampleur insoupçonnée (³).
D’après une étude anglaise, sur 11000 Britanniques de 33
ans, les femmes les moins séduisantes percevaient un salaire inférieur
de 11% à la moyenne nationale. Les femmes obèses perdent également 5%
de salaire. Aux Etats-Unis, les femmes entrepreneuses dans le secteur
des cosmétiques gagnent plus lorsqu’elles sont belles : les 20% les
plus séduisantes gagnent 20% de plus que les 20% les moins attrayantes (³).
La beauté est une sorte de diplôme, ou du moins de
passeport, de capital humain que le marché du travail reconnaît
financièrement. Ces différences de salaire s’expliquent aussi par des
différences de carrière, qui dépendent en partie de l'apparence.
Les individus subissent donc des contraintes massives et
constantes, mais aussi très précises et pointilleuses. Ce qui
marginalise, exclut, complexe et culpabilise tous ceux qui s'éloignent
et se différencient des stéréotypes proposés. Nous voilà alors
confrontés à un certain paradoxe : nous sommes libres, nous devons
l'être pour pouvoir devenir ce que nous sommes, c'est-à-dire pour être
nous-mêmes. Mais lorsque notre "moi-même" ne correspond pas au modèle
dicté par la société, celle-ci nous rejette, et l'accomplissement de
soi devient alors impossible.
Pour être bien dans sa peau, autrement dit être "soi-même",
il faut répondre aux critères de beauté de la société, chose totalement
paradoxale. Comme le dit si bien la philosophe contemporaine Michela
Marzano, « au nom de la liberté, le corps doit "suivre", encore et
encore, certaines normes : […] il est ce qui doit se conformer aux lois
du savoir vivre qui, aujourd'hui, lui imposent d'être toujours beau,
mince, sain, désirable, sexy...libre ».
Le choix est simple : ou on se soumet, ou on est exclu ;
ceci revient à dire que l'on n'a pas le choix, et sans choix, il n'y a
pas de liberté. La liberté est donc illusoire, on nous demande de
librement nous plier.
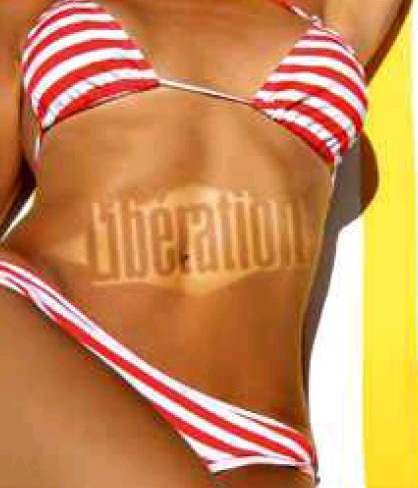
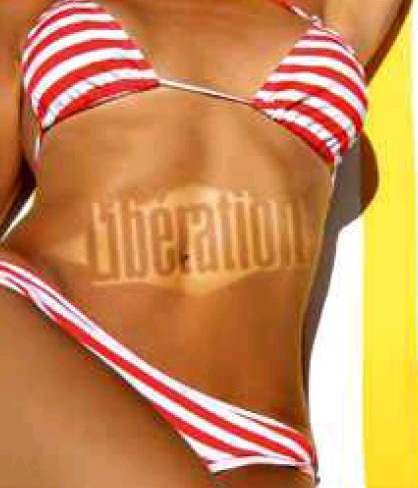
Les pratiques apparemment les plus
libérés des contraintes sont en fait extrêmement codifiées. Le corps nu
ne doit surtout pas être animal, il ne doit être ni flasque ni mou, ne
doit pas se laisser aller, mais doit être au contraire lisse, épilé,
bronzé et musclé. Ceci est la nouvelle forme du corps libre.
En effet, on a l’impression
qu’aujourd’hui les tabous sont
tombés, que le corps est libéré, mais en réalité ce n’est que sa
représentation qui l’est, se trouvant remaniée de façon tout aussi
contraignaite, puisque la norme est de posséder un corps ainsi fait.
La libération du corps n’est donc que l’intériorisation des
normes, des standards, des impératifs et des interdits. Un nouveau stéréotype est apparu, plus
fort, plus présent et plus coercitif.
Avec cela un nouveau paradoxe s'est fait
jour : les filles
doivent s'habiller "sexy", comme le leur montrent les images
autour
d'elles, mais c'est aussi à elles de faire attention, de ne pas
provoquer. Dans de telles circonstances, il semble y avoir peu de
solidarité féminine, et on voit naître une rivalité entre les filles
dites "normales" et les filles "sexy", les unes parfois frustrées de ne
pas rentrer dans le moule, les autres parfois trop faibles pour
résister à l'image sexy imposée.
(³) DARMON M. et DETREZ C. « Problèmes politiques et sociaux : Corps et société » n°907 décembre 2004
(³) DARMON M. et DETREZ C. « Problèmes politiques et sociaux : Corps et société » n°907 décembre 2004



